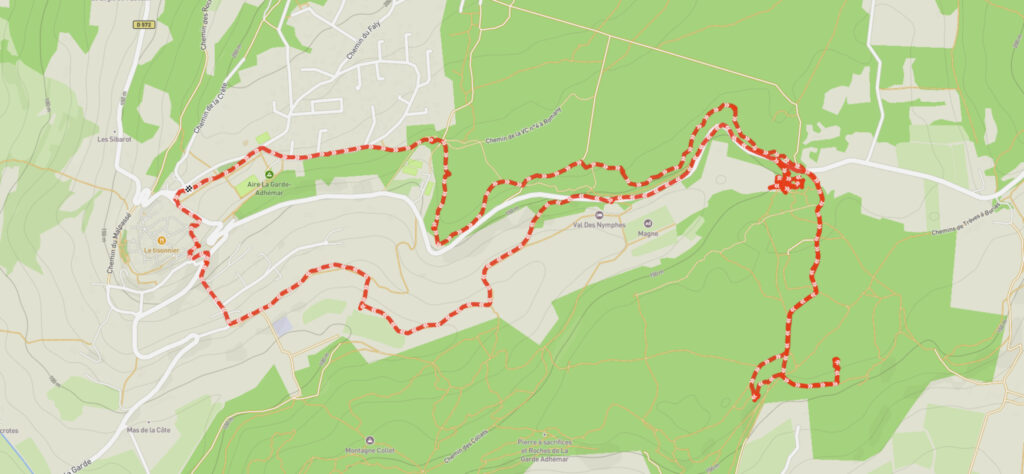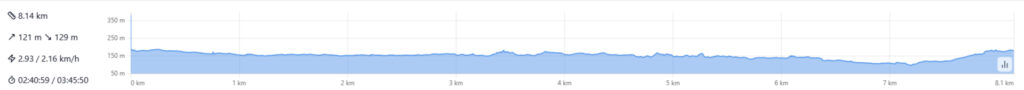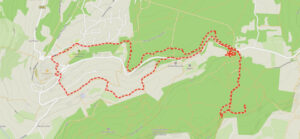Dès notre arrivée, nous sommes reçus par Bernard Hernandez, président du Club Histoire et Patrimoine de La Garde-Adhémar, qui contribue activement à la valorisation et à la sauvegarde de ce beau village.
Nous progressons au sud du quartier des Montjars, par un sentier de crête en sous-bois qui propose quelques vues panoramiques sur la vallée du Rhône et le village de La Garde, dont l’implantation remonte au XIIe s.
L’église paroissiale surmontée d’un élégant clocher appartient en grande partie à cette période. Au XVIe s., Antoine Escalin Des Aymars, homme de guerre, baron de La Garde, ambassadeur, général en chef des galères royales, y fait édifier un magnifique château Renaissance du style de celui de Grignan, démantelé à la Révolution.
Arrivés à la hauteur du Val des Nymphes, nous partons à la recherche de cuves lapidaires, creusées à même le rocher, qui ont donné lieu à bien des interprétations fantaisistes. Il s’agirait de cuves de foulage à raisins, qui auraient été utilisées lors du premier millénaire de notre ère.
La vinification se faisait sur place, au milieu ou à proximité des vignes.
Le jus s’écoulait par un bec verseur dans des poteries ou des outres placées en dessous. Le procédé est reproduit sur des mosaïques romaines.
On retrouve ensuite le Val des Nymphes, un site admirable dans un écrin de chênes centenaires, dont l’importante source aurait fixé un habitat très ancien dès l’époque gallo-romaine et au Haut Moyen Age. Un culte antique aux mères nymphes, divinités des eaux, y est attesté.
A proximité, le prieuré est un bel exemple d’architecture romane provençale. Le monument fut restauré en 1991 et retrouve une couverture. Intérieurement, l’abside est à deux séries d’arcatures surmontées d’un cul-de-four. La façade offre dans sa partie supérieure un décor en arc de triomphe (un triplet), inspiré de l’antique. Elle est flanquée d’imposants arcs-boutants montés au XVIIe s.
On remarque partout des marques de tâcherons incisées dans la pierre, laissés par les tailleurs ou les ateliers. Leur fonction exacte n’est pas certaine.
Retour par la partie basse du Val. Arrêt devant la grande bâtisse de Magne, une ancienne filature du XIXe s. Le personnel de l’usine était composé d’une centaine d’ouvrières recrutées dès quatorze ans.
Un terrible accident y eut lieu en mars 1859, avec une explosion de la chaudière tuant une dizaine de personnes.
Un grand merci à Bernard pour ses nombreuses explications, tant géographiques qu’historiques, tout au long de cette superbe randonnée, malgré un fort mistral gâchant un peu la sortie.